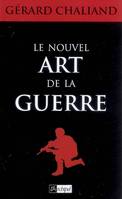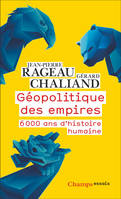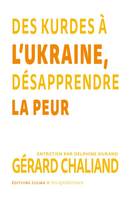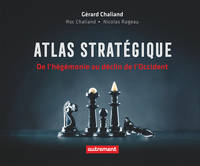- EAN13
- 9782809800661
- ISBN
- 978-2-8098-0066-1
- Éditeur
- Archipel
- Date de publication
- 07/05/2008
- Collection
- Histoire
- Nombre de pages
- 168
- Dimensions
- 10 x 10 x 2 cm
- Poids
- 222 g
- Langue
- français
- Code dewey
- 355.001
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Autre version disponible
DU MÊME AUTEUR
POLITIQUE
Mythes révolutionnaires du tiers-monde, Seuil, 1976 ; 1979.
L'Enjeu africain, Seuil, 1980; Complexe, 1982.
Repenser le tiers-monde, Complexe, 1987.
Le Malheur kurde, Seuil, 1992.
État de crise, vers les nouveaux équilibres mondiaux (avec J. Minces), Seuil, 1993.
Voyage dans le demi-siècle (avec J. Lacouture et A. Versaille), Complexe, 2001.
America is back: les nouveaux Césars du Pentagone (avec A. Blin), Bayard, 2003.
L'Amérique en guerre : Irak, Afghanistan, Le Rocher, 2007.
ENQUÊTES
L'Algérie est-elle socialiste ?, Maspéro, 1964.
Lutte armée en Afrique, Maspéro, 1967.
Les Paysans du Nord-Viêtnam et la guerre, Maspéro, 1968.
La Résistance palestinienne, Seuil, 1970.
L'Algérie indépendante (avec J. Minces), Maspéro, 1972.
Rapport sur la résistance afghane, Berger-Levrault, 1981.
Où va l'Afrique du Sud ?, Calmann-Lévy, 1986.
Un itinéraire combattant, Karthala, 1997.
Guérillas, du Viêtnam à l'Irak, Pluriel, 2008.
STRATÉGIE MILITAIRE
Atlas stratégique géopolitique des rapports de force dans le monde (avec J.-P. Rageau), Fayard, 1983 ; Complexe, 1993.
Terrorisme et Guérillas, Flammarion, 1985 ; Complexe, 1987.
Anthologie mondiale de la stratégie, « Bouquins », Laffont, 1990 ; 1993 ; 2001 ; 2004 ; 2008.
Atlas du nucléaire civil et militaire (avec M. Jan), Payot, 1993.
Les Empires nomades, de la Mongolie au Danube, Tempus, 1998.
Le Chantier stratégique, entretiens avec Lucien Poirier, Hachette, 1997.
Dictionnaire de stratégie militaire (avec A. Blin), Perrin, 1998.
L'Arme du terrorisme, Audibert, 2002.
Mao, stratège révolutionnaire, textes choisis et introduction, Le Félin, 2002.
Histoire du terrorisme, De l'Antiquité à Al-Qaida (avec A. Blin), Bayard, 2004.
Guerres irrégulières, XXe-XXIe siècles, Folio, 2008.
www.editionsarchipel.com
Si vous souhaitez recevoir notre catalogue et
être tenu au courant de nos publications,
envoyez vos nom et adresse, en citant ce
livre, aux Éditions de l'Archipel,
34, rue des Bourdonnais 75001 Paris.
Et, pour le Canada, à
Édipresse Inc., 945, avenue Beaumont,
Montréal, Québec, H3N 1W3.
eISBN 978-2-8098-1095-0
Copyright © L'Archipel, 2008.
À la mémoire de mon ami
Jean-Paul Rospars
« Plenty and peace breeds cowards ;
Hardness even of hardiness is mother. »
(« La paix et l'abondance engendrent les lâches ;
la nécessité fut toujours mère de l'audace. »)
William SHAKESPEARE, Cymbeline
NOTE LIMINAIRE
L'objet de ce livre est double.
D'une part, il cherche à répondre à la question suivante: les troupes occidentales peuvent-elles, aujourd'hui, gagner des guerres irrégulières comme celles d'Irak ou d'Afghanistan, par exemple ?
D'autre part, il s'agit d'examiner par quelle évolution les troupes européennes, au cours du siècle qui précéda la Seconde Guerre mondiale, ont toujours fini par triompher dans les guerres coloniales, tandis que, depuis 1945, à de rares exceptions près, les guérillas auxquelles les troupes occidentales s'opposent n'ont pu être éradiquées.
Cette évolution ne s'explique pas d'un point de vue strictement militaire et moins encore par l'armement seul. La supériorité des armes est, de façon évidente, toujours du côté occidental. Où résident alors les causes de ce retournement? C'est, en définitive, dans les réponses à cette seconde question que se trouvent les éléments permettant de répondre à la première.
Le lecteur pressé, qui ne s'intéresse que modérément à la généalogie de la guerre et au contexte historique qui la détermine, peut se reporter directement à la deuxième partie de ce livre.
Introduction
La guerre entre groupes, empires ou États est une activité aussi ancienne que l'espèce humaine. La question de savoir si elle résulte d'une agressivité naturelle ou de la nécessité est d'un intérêt limité pour le stratégiste, qui constate le phénomène et cherche à l'analyser, à situer tel conflit selon ses caractéristiques dans la généalogie des guerres, non à le juger sur le plan moral.
Jadis, la défaite se soldait par l'esclavage et la déportation. La conquête, profitable, était légitimée par un ordre naturel du monde, réglé par les divinit és des vainqueurs. La question de la guerre juste, posée par saint Augustin, au terme de près de quatre mille années de conflits historiques, trouve peut-être sa réponse mille ans plus tard avec Machiavel qui déclare, en substance, qu'une guerre est juste lorsqu'elle est nécessaire. Quoi qu'il en soit, la guerre a été considérée durant très longtemps comme une activité sociale ne nécessitant aucune justification. C'est encore le cas dans d'autres sociétés aujourd'hui.
Le caractère de la guerre se modifie selon la société, l'économie, la technologie et l'esprit du temps. Chaque époque, comme chaque société, fait la guerre d'une manière qui correspond non seulement à ce qu'on appelle sa culture stratégique, mais à l'évolution de ses données politiques et sociales.
Tous ceux qui sont quelque peu familiers des transformations de la guerre au cours des derniers siècles savent qu'entre 1792 et 1945 l'Europe a connu la guerre que Lazare Carnot dénommait « à outrance ».
Celle-ci était due à des facteurs sociaux et culturels nouveaux, conséquences de la Révolution fran çaise. La proclamation des Droits de l'homme et du citoyen marque l'avènement de la démocratie sur le continent européen. La levée en masse remplace le mercenariat, annonçant les grandes guerres nationales à caractère absolu ; ces dernières étant en somme filles de la démocratie. L'aboutissement du nationalisme exacerbé mène à la guerre totale où, bientôt, les populations civiles sont prises pour cibles, autant sinon plus que les forces armées.
L'apparition du feu nucléaire, en 1945, constitue la plus considérable des mutations dans les affaires militaires, celle-ci étant qualitative et non plus quantitative, tels, par exemple, les progrès du feu entre 1860-70 et 1914, qui furent une surprise majeure de la Première Guerre mondiale. Depuis cette date, durant ce qu'on a appelé la « guerre froide », où l'équilibre entre les deux super-puissances reposait sur la dissuasion, les conflits classiques ont été limit és en nombre : guerres israélo-arabes, indo-pakistanaises, guerre de Corée, guerre des Malouines, guerre irako-iranienne.
En revanche, la carte du monde, dans les trente années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a surtout été modifiée par des guerres irrégulières. Guérillas et actes de terrorisme ont eu, dans le cadre du nouvel esprit du temps, une importance qu'ils n'avaient pas connue au cours de la grande expansion impériale de l'Europe durant le XIXe siècle et le début du XXe.
En dehors de la guerre des Boers (1899-1902), qui opposait des « Blancs », pour utiliser le vocabulaire de l'époque, aucune de ces petites guerres coloniales n'a véritablement eu d'écho important au sein des opinions publiques européennes. Bien qu'il ait été flatteur, pour l'orgueil national, d'accroître les territoires de l'empire, les préoccupations politiques et stratégiques majeures étaient tournées vers les concurrents européens.
Les États qui comptaient étaient la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Italie et bientôt le Japon. Les États-Unis étaient, jusqu'en 1917, surtout soucieux de l'hémisph ère Ouest, du Pacifique et de la liberté des mers.
Les préoccupations majeures, entre 1815 et 1914, concernent l'équilibre européen assuré par le traité de Vienne, qui établit la prééminence britannique. Celle-ci fait suite à la longue hégémonie continentale française, qui s'étend de 1648 à 1815, fondée, entre autres, sur une écrasante supériorité démographique. La France perd sa première place de puissance militaire terrestre en 1871, au profit d'une Allemagne qui devient, en 1890, la grande puissance industrielle européenne.
Les États-Unis représentent, en 1900, près du tiers de la production industrielle mondiale. La Russie, attardée mais démographiquement et militairement puissante, se taille au XIXe siècle un empire par continuité territoriale ; le transsibérien relie bientôt Moscou à Vladivostok.
La révolution industrielle, qui fait suite à l'exceptionnelle révolution intellectuelle des Lumières, a...
POLITIQUE
Mythes révolutionnaires du tiers-monde, Seuil, 1976 ; 1979.
L'Enjeu africain, Seuil, 1980; Complexe, 1982.
Repenser le tiers-monde, Complexe, 1987.
Le Malheur kurde, Seuil, 1992.
État de crise, vers les nouveaux équilibres mondiaux (avec J. Minces), Seuil, 1993.
Voyage dans le demi-siècle (avec J. Lacouture et A. Versaille), Complexe, 2001.
America is back: les nouveaux Césars du Pentagone (avec A. Blin), Bayard, 2003.
L'Amérique en guerre : Irak, Afghanistan, Le Rocher, 2007.
ENQUÊTES
L'Algérie est-elle socialiste ?, Maspéro, 1964.
Lutte armée en Afrique, Maspéro, 1967.
Les Paysans du Nord-Viêtnam et la guerre, Maspéro, 1968.
La Résistance palestinienne, Seuil, 1970.
L'Algérie indépendante (avec J. Minces), Maspéro, 1972.
Rapport sur la résistance afghane, Berger-Levrault, 1981.
Où va l'Afrique du Sud ?, Calmann-Lévy, 1986.
Un itinéraire combattant, Karthala, 1997.
Guérillas, du Viêtnam à l'Irak, Pluriel, 2008.
STRATÉGIE MILITAIRE
Atlas stratégique géopolitique des rapports de force dans le monde (avec J.-P. Rageau), Fayard, 1983 ; Complexe, 1993.
Terrorisme et Guérillas, Flammarion, 1985 ; Complexe, 1987.
Anthologie mondiale de la stratégie, « Bouquins », Laffont, 1990 ; 1993 ; 2001 ; 2004 ; 2008.
Atlas du nucléaire civil et militaire (avec M. Jan), Payot, 1993.
Les Empires nomades, de la Mongolie au Danube, Tempus, 1998.
Le Chantier stratégique, entretiens avec Lucien Poirier, Hachette, 1997.
Dictionnaire de stratégie militaire (avec A. Blin), Perrin, 1998.
L'Arme du terrorisme, Audibert, 2002.
Mao, stratège révolutionnaire, textes choisis et introduction, Le Félin, 2002.
Histoire du terrorisme, De l'Antiquité à Al-Qaida (avec A. Blin), Bayard, 2004.
Guerres irrégulières, XXe-XXIe siècles, Folio, 2008.
www.editionsarchipel.com
Si vous souhaitez recevoir notre catalogue et
être tenu au courant de nos publications,
envoyez vos nom et adresse, en citant ce
livre, aux Éditions de l'Archipel,
34, rue des Bourdonnais 75001 Paris.
Et, pour le Canada, à
Édipresse Inc., 945, avenue Beaumont,
Montréal, Québec, H3N 1W3.
eISBN 978-2-8098-1095-0
Copyright © L'Archipel, 2008.
À la mémoire de mon ami
Jean-Paul Rospars
« Plenty and peace breeds cowards ;
Hardness even of hardiness is mother. »
(« La paix et l'abondance engendrent les lâches ;
la nécessité fut toujours mère de l'audace. »)
William SHAKESPEARE, Cymbeline
NOTE LIMINAIRE
L'objet de ce livre est double.
D'une part, il cherche à répondre à la question suivante: les troupes occidentales peuvent-elles, aujourd'hui, gagner des guerres irrégulières comme celles d'Irak ou d'Afghanistan, par exemple ?
D'autre part, il s'agit d'examiner par quelle évolution les troupes européennes, au cours du siècle qui précéda la Seconde Guerre mondiale, ont toujours fini par triompher dans les guerres coloniales, tandis que, depuis 1945, à de rares exceptions près, les guérillas auxquelles les troupes occidentales s'opposent n'ont pu être éradiquées.
Cette évolution ne s'explique pas d'un point de vue strictement militaire et moins encore par l'armement seul. La supériorité des armes est, de façon évidente, toujours du côté occidental. Où résident alors les causes de ce retournement? C'est, en définitive, dans les réponses à cette seconde question que se trouvent les éléments permettant de répondre à la première.
Le lecteur pressé, qui ne s'intéresse que modérément à la généalogie de la guerre et au contexte historique qui la détermine, peut se reporter directement à la deuxième partie de ce livre.
Introduction
La guerre entre groupes, empires ou États est une activité aussi ancienne que l'espèce humaine. La question de savoir si elle résulte d'une agressivité naturelle ou de la nécessité est d'un intérêt limité pour le stratégiste, qui constate le phénomène et cherche à l'analyser, à situer tel conflit selon ses caractéristiques dans la généalogie des guerres, non à le juger sur le plan moral.
Jadis, la défaite se soldait par l'esclavage et la déportation. La conquête, profitable, était légitimée par un ordre naturel du monde, réglé par les divinit és des vainqueurs. La question de la guerre juste, posée par saint Augustin, au terme de près de quatre mille années de conflits historiques, trouve peut-être sa réponse mille ans plus tard avec Machiavel qui déclare, en substance, qu'une guerre est juste lorsqu'elle est nécessaire. Quoi qu'il en soit, la guerre a été considérée durant très longtemps comme une activité sociale ne nécessitant aucune justification. C'est encore le cas dans d'autres sociétés aujourd'hui.
Le caractère de la guerre se modifie selon la société, l'économie, la technologie et l'esprit du temps. Chaque époque, comme chaque société, fait la guerre d'une manière qui correspond non seulement à ce qu'on appelle sa culture stratégique, mais à l'évolution de ses données politiques et sociales.
Tous ceux qui sont quelque peu familiers des transformations de la guerre au cours des derniers siècles savent qu'entre 1792 et 1945 l'Europe a connu la guerre que Lazare Carnot dénommait « à outrance ».
Celle-ci était due à des facteurs sociaux et culturels nouveaux, conséquences de la Révolution fran çaise. La proclamation des Droits de l'homme et du citoyen marque l'avènement de la démocratie sur le continent européen. La levée en masse remplace le mercenariat, annonçant les grandes guerres nationales à caractère absolu ; ces dernières étant en somme filles de la démocratie. L'aboutissement du nationalisme exacerbé mène à la guerre totale où, bientôt, les populations civiles sont prises pour cibles, autant sinon plus que les forces armées.
L'apparition du feu nucléaire, en 1945, constitue la plus considérable des mutations dans les affaires militaires, celle-ci étant qualitative et non plus quantitative, tels, par exemple, les progrès du feu entre 1860-70 et 1914, qui furent une surprise majeure de la Première Guerre mondiale. Depuis cette date, durant ce qu'on a appelé la « guerre froide », où l'équilibre entre les deux super-puissances reposait sur la dissuasion, les conflits classiques ont été limit és en nombre : guerres israélo-arabes, indo-pakistanaises, guerre de Corée, guerre des Malouines, guerre irako-iranienne.
En revanche, la carte du monde, dans les trente années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a surtout été modifiée par des guerres irrégulières. Guérillas et actes de terrorisme ont eu, dans le cadre du nouvel esprit du temps, une importance qu'ils n'avaient pas connue au cours de la grande expansion impériale de l'Europe durant le XIXe siècle et le début du XXe.
En dehors de la guerre des Boers (1899-1902), qui opposait des « Blancs », pour utiliser le vocabulaire de l'époque, aucune de ces petites guerres coloniales n'a véritablement eu d'écho important au sein des opinions publiques européennes. Bien qu'il ait été flatteur, pour l'orgueil national, d'accroître les territoires de l'empire, les préoccupations politiques et stratégiques majeures étaient tournées vers les concurrents européens.
Les États qui comptaient étaient la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Italie et bientôt le Japon. Les États-Unis étaient, jusqu'en 1917, surtout soucieux de l'hémisph ère Ouest, du Pacifique et de la liberté des mers.
Les préoccupations majeures, entre 1815 et 1914, concernent l'équilibre européen assuré par le traité de Vienne, qui établit la prééminence britannique. Celle-ci fait suite à la longue hégémonie continentale française, qui s'étend de 1648 à 1815, fondée, entre autres, sur une écrasante supériorité démographique. La France perd sa première place de puissance militaire terrestre en 1871, au profit d'une Allemagne qui devient, en 1890, la grande puissance industrielle européenne.
Les États-Unis représentent, en 1900, près du tiers de la production industrielle mondiale. La Russie, attardée mais démographiquement et militairement puissante, se taille au XIXe siècle un empire par continuité territoriale ; le transsibérien relie bientôt Moscou à Vladivostok.
La révolution industrielle, qui fait suite à l'exceptionnelle révolution intellectuelle des Lumières, a...
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
Géopolitique des empires, 6000 ans d'histoire humaineGérard Chaliand, Jean-Pierre RageauFlammarion10,00
-
Atlas stratégique, De l'hégémonie au déclin de l'OccidentRoc Chaliand, Gérard Chaliand, Nicolas RageauAutrement24,90